 Le
jardin de l'Hôtel de Ville, depuis sa création dans
les années 1730 a généralement pris le nom
de la grande bâtisse qui lui fait face. En conséquence,
il fut appelé jardin de l'Archevêché, à
l'époque où l'Archevêque de Bourges logeait
à quelques pas de sa Cathédrale.
Le
jardin de l'Hôtel de Ville, depuis sa création dans
les années 1730 a généralement pris le nom
de la grande bâtisse qui lui fait face. En conséquence,
il fut appelé jardin de l'Archevêché, à
l'époque où l'Archevêque de Bourges logeait
à quelques pas de sa Cathédrale.
Une histoire lointaine :
En mai 1676, l'archevêque de Bourges,
Michel Poncet, qui va mourir l'année suivante va obtenir
la possibilité de clôturer les abords de son palais.
Son successeur, Phélypeaux de La
Vrillère désir agrandir son palais et créer
un jardin.
A l'origine, ce petit jardin était
à l'intérieur de la ville médiévale,
en limite des remparts. Il fut effectivement agrandi par Monseigneur
Phélypeaux de la Vrillère, en comblant les fossés
situés au Nord, et à renfermer dans des murs "
le fossé et la contre-escarpe qui joignait l'extrémité
sud de Notre-Dame-de-Salles à la porte Bourbonnoux"
Mais il s'agissait d'une zone avec des
fortifications et cela dépendait du domaine royal, d'où
la demande qui sera faite à Louis XIV le 12 août
1681 qui donne son accord avec pour condition, la construction
d'un mur de 14 pieds de haut au-dessus du rez-de-chaussée
et de 8 pieds d'épaisseur dans son fondement , avec en
plus un espace pour un petit parapet afin de permettre le passage
des rondes en temps de guerre ... On pensait à tout !
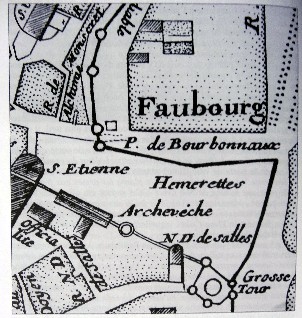
En 1686, il va clôturer dans on enclos,
les ormes qui avaient été plantés par le
maire M. Hémeré et 1654, le rue dite des Hémerettes
provient du nom de ce maire.
Finalement, ce terrain est donné
par la ville pour laisser "Monseigneur en jouir lui et ses
successeurs, pleinement et perpétuellement".
Le mur est alors réalisé
en pierre de La Celle, la hauteur est de 16 à 18 pieds.
C'est Mgr de La Rochefoucault en 1729 qui
va après quelques temps à Bourges faire aménager
cet espace en jardin.
Le jardin de Le Notre ?
La légende veut que dans son dessin
actuel le jardin soit signé par le grand paysagiste Le
Nôtre.
Il s'agit d'une hypothèse peu plausible puisque Le Notre,
à qui l'on doit les parterres de Vaux le Vicomte et ceux
de Versailles est mort en 1700, et le jardin berruyer dans sa
structure actuelle ne fut terminé que 30 ans plus tard.
Pourtant, le classicisme du jardin est sans aucun doute l'oeuvre
d'un des élèves de Le Notre, avec ses parterres
carrés et alignés.
Au début de l'année 1731,
le jardin est encore planté de 200 ormes et marronniers
d'Indes, et il faut les abattre ! Puis les vendre. Et il faut
l'autorisation du Maître des Eaux-et-Forêts, qu'il
obtient le 28 janvier 1731.

C'est ensuite le devis et la description
des travaux à faire, c'est à dire la construction
d'un massif de maçonnerie pour poser les marches d'une
terrasse, pour faire une orangerie. Celle-ci sera construite
près de la cour de l'Officialité, entre le rempart
et le mur du cimetière des chapelains.
Le terrain est inégal et il faut
niveler le tout puis remplacer les mauvaises terres qui seront
remplacées par des bonnes "prises sur le revers des
fossés de la ville, à côté de la Porte
Bourbonnoux".
Les détails sont donnés comme
la terrasse donnera sur le jardin par quatre marches.
En 1741, l'hiver est rigoureux, le cardinal
de La Rochefoucault met en oeuvre un atelier de charité
pour employer les pauvres et les chômeurs. Il fait niveler
les terres entassées en dehors de la porte Bourbonnoux
et crée une place qui sera plantée d'arbres qui
sera la Place-Misère.
Plus tard l'évêque Torné
veut vendre une partie du palais qu'il juge trop grand !
C'est en 1793 que le palais épiscopal
devient la propriété du département et le
jardin est alors une promenade publique. L'entretien du jardin
se fait par ... la ville. Et comme il y a du vandalisme le préfet
en 1800, Legendre de Luçay décide que le jardin
étant propriété communale, ce qui était
faux, son entretien sera bien à faire par la ville.
Il faut dire que des arbres sont abattus,
des parterres endommagés, et des animaux erraient dans
le jardin, comme des ... chèvres !
Le résultat, c'est la nomination
d'un gardien.
On notera aussi la présence de deux
statues Bacchus et Flore au centre de chacun des deux grands
massifs. Ces sculpture dont on ne sait pas grand chose seront
vendues aux enchères en 1813.
Ces deux statues étaient pour l'archevêque
incompatibles avec son logement car elles manquaient de décence...
Ce devaient être des nus ? Et il s'agissait de divinités
païennes.
En 1821, les bâtiments de l'Officialité
sont démolis ce qui permet un accès direct depuis
le parvis sud de la cathédrale jusque dans le jardin.
Mais comme le jardin est de plus en plus
fréquenté par des ouvriers, des soldats "et
toute sorte de personnes de passage qui peuvent tout voir à
l'intérieur du palais", il est décidé
à cette date de mettre en place un grille de 5 pieds de
hauteur, en fer rond, scellés par une longue file de pierres
dures servant de socle.
En 1823, on construit un logement pour
le portier et il place en ce lieu ses outils et les brouettes.
Il s'agissait de la seule entrée.
Les enfants de moins de 12 ans sont exclus si ils ne sont pas
accompagnés de leurs parents.
On notera qu'en 1828, un puits artésien
est foré et cela va durer 5 ans ... sans succès
semble-t-il.
Une porte supplémentaire est construite
rue des Hémerettes, la grille venant de la Porte Saint-Michel,
c'est la seule porte qui s'ouvre "hors de la ville".
Au pied de la Cathédrale Saint Etienne, le Jardin de l'Hôtel
de Ville, d'une superficie de 3 hectares, est magnifiquement
fleuri en toute saison. Il comprend une partie dite " à
la française ", et l'autre, avec de grands arbres
et un kiosque à musique est dite " à l'anglaise
".
Ce jardin comporte peu de statues. On remarque
l'Obélisque, au fond, proche des grilles monumentales
récupérées de la Porte d'Auron. Cet Obélisque,
dédié à la mémoire du duc de Béthune-Charost
est sans valeur artistique, à sa vue Stendhal écrira
: " J'y ai trouvé un monument élevé
à un grand citoyen qui a perfectionné le mouton".
Stendhal, dans son ouvrage des "Mémoires d'un Touriste"
racontera ses flâneries dans ce jardin lorsqu'il vint en
Berry en 1837. Il écrira encore :
"Ce jardin a des bancs forts
commodes, à dossier comme ceux de Londres, ce qui a commencé
à me donner un grand respect pour le Maire de la ville.
A l'aide d'un de ces bancs, j'ai lu presque tout le Roméo
de Shakespeare".
Outre le souvenir de Stendhal, le jardin de l'Hôtel de
Ville comporte les bustes de deux Berruyers, Bourdaloue et Sigaud
de Laffond. Ce sont deux bronzes magnifiques signés de
Jules Dumoutet, le premier rend hommage au prédicateur
inventeur du vase de nuit qui porte son nom... Le second personnage
est injustement peu connu, il est l'auteur de traités
sur " l'art de l'accouchement ", les femmes lui doivent
beaucoup.

Les fleurs et leur agencement donnent une
vue féerique de la cathédrale Saint Etienne, et
le passant ne peut manquer d'admirer les 4 vases de Cugnot, appelés
" les quatre saisons ". Ces oeuvres datent de 1880,
elles avaient été fabriquées par la Maison
Christofle ils sont en bronze galvanique, alors que les magnifiques
angelots, au dessus de la coupole sont eux en bronze véritable.
Ils ont été rénovés ces dernières
années.